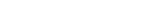De la visite gynécologique à l’accouchement, les femmes exposent ce qu’il est d’usage de cacher. Dans leur savoir-faire et savoir-être, l’immense majorité des professionnels de santé facilite ces moments. D’autres beaucoup moins. Parler des violences obstétricales et gynécologiques, c’est toucher du doigt, sans mauvais jeu de mot, un grand tabou. Récit de ces Bourguignonnes meurtries dans leur chair et leur intimité.
Par Julie Letourneur / Illustrations : Jodie Bougaud
Tout est parti d’une discussion entre femmes sur les pratiques gynécologiques douteuses, qui ont trouvé un large écho médiatique. Pas de ça chez nous, pas au XXIe siècle, c’est du mythe ! Mais quand on y prête une oreille attentive et bienveillante, la parole se libère. Et les femmes décrivent l’impensable.
Elles témoignent, en majorité anonymement, pour que d’autres puissent réagir quand elles, se sont trouvées dépassées. À 48 ans, Chloé* a trois enfants dont elle a respectivement accouché au Creusot, à Chalon-sur-Saône et à Dijon. Elle voudrait que les jeunes femmes soient préparées à ce qu’elles peuvent affronter, ou au moins débarrassées d’une certaine candeur autour de la question. « Quand on n’a jamais eu d’enfants, on ne sait pas ce qui peut arriver. Les gynécologues devraient informer, même des pratiques les plus horribles. »
Le point du mari
L’épisiotomie, opération consistant à élargir le vagin et faciliter le passage de l’enfant, peut s’avérer violente. Dans la tête et dans la chair, la mère de famille garde les stigmates de celle qu’on lui a faite en Sâone-et-Loire. « Après la naissance de mon dernier enfant, ma gynécologue m’a fait remarquer que j’avais été recousue un peu plus que nécessaire. J’ai fait des recherches et j’ai compris que le médecin, un homme, m’avait fait le point du mari. » Soit une suture supplémentaire pour resserrer l‘entrée du vagin, et permettre supposément, lors de l’intromission de Monsieur, un plaisir accentué. Rien que pour lui. De la mutilation en bonne et due forme.
Au CHU de Dijon, le professeur Paul Sagot est atterré à l’idée que cette pratique existe, préférant y voir une jonction mal faite. « Une suture d’épisiotomie doit être faite de façon aussi attentive que pour un visage, ce n’est pas un geste anodin, il doit respecter l’anatomie », explique posément le chef de service gynécologie-obstétrique, par ailleurs président du Réseau périnatal de Bourgogne. Sauf que derrière la bonne foi, il y a les faits. Daphné*, Dijonnaise de 41 ans, raconte comment son gynécologue, après une épisiotomie déplaisante et douloureuse, lui a demandé tout net : « Vous en avez besoin pour votre travail ? ». Après un silence ahuri en retour, le professionnel a enchaîné, « dans ce cas, ce n’est pas si grave ». Merci, bonne journée. La gynécologue de l’auteure de ces lignes, qui lui demanda un jour si elle avait un miroir chez elle pour faire allusion à son surpoids, passe soudain pour une enfant de chœur.
Le poids de l’urgence
Les témoignages pourraient refroidir les futures mamans face à ce type d’intervention, à condition que la patiente, en plein accouchement, puisse avoir le choix. Le professeur Sagot privilégie naturellement l’écoute et le dialogue, avant la naissance et pendant l’accouchement. Il n’en oublie pas pour autant l’urgence médicale. « On essaie de respecter les choses le plus possible, mais nous n’avons que quelques secondes pour prendre une décision… » Sarah, sage-femme au CHU de Chalon-sur-Saône abonde plus fermement : « Je ne demande pas l’avis d’une patiente dans l’urgence. Je la préviens mais je ne lui laisse pas le choix. Cela ne nous fait pas plaisir de couper la chair d’une femme mais nous savons ce qui est urgent et pertinent pour l’intérêt vital de l’enfant. »
La professionnelle va plus loin. « La femme n’est pas forcément en état d’avoir le bon jugement et nous n’avons pas cinq minutes pour tout expliquer. » Chloé*, la maman de trois enfants, ne partage pas ce point de vue. « Même en cas d’urgence, on doit nous laisser le choix et la maîtrise de notre corps. En accouchant, la femme est consciente, capable d’évaluer ce qui est bon pour elle et son enfant. On ne doit pas subir les choses. »
Se voulant rassurant, le professeur Sagot annonce un taux d’épisiotomie globalement à la baisse en région. « En Bourgogne, elle ne concerne plus que 10,6% des accouchements en 2016. Au CHU de Dijon, nous sommes passés de 6.5% en 2016 à 3.3% en 2017. On a longtemps pensé que cette opération diminuait les incontinences urinaires, mais les données et la littérature ont montré que cela n’avait finalement aucune justification. » La médecine évolue, les pratiques aussi, tout comme les demandes des patientes désireuses d’accoucher de côté, « à quatre pattes » ou dans une baignoire grâce aux salles naturelles installées dans les CHU. Sarah, la sage-femme, se réjouit de ces évolutions même si tout le monde n’approuve pas. « Des consœurs plus anciennes appellent ça des positions à la con. » Autre époque, autres mœurs.
Pas touche !
De façon plus générale, les femmes dévoilent leur intimité à un médecin en toute confiance. Elles doivent s’assurer d’avoir le bon interlocuteur, c’est la base. Paul Sagot estime que chaque année, en France, 5 à 10 professionnels de santé sont accusés d’attouchement. Les pires choses n’arrivant qu’aux autres, difficile donc d’imaginer que dans un hôpital à côté de chez nous ou dans le cabinet au coin de la rue, de telles pratiques existent. « Il y a des brebis galeuses partout, et nous excluons du bloc ceux qui ont des comportements ambigus », tranche le médecin. Et pourtant… Daphné* a été surprise que son gynécologue libéral stimule son clitoris pour provoquer une lubrification naturelle avant un toucher vaginal. « Sur le coup, on ne sait pas, on fait confiance au médecin mais en y repensant, j’ai été choquée. » Chloé*, de son côté, a été confrontée à un gynécologue particulièrement friand de palpations mammaires, prescrivant des méthodes dignes des remèdes de grand-mère. « Pour arrêter mes montées de lait, il m’a fait bander les seins pendant plusieurs jours. C’était douloureux mais je pensais que c’était ce qu’il fallait faire vu qu’il me l’avait prescrit. Heureusement, j’en ai parlé autour de moi et j’ai compris… » Cet abus de confiance se retrouve ailleurs. Daphné*, toujours elle, a donné son accord pour que des internes en médecine procèdent à des touchers vaginaux afin d’apprendre à évaluer la dilatation de l’utérus. « Il faut qu’ils apprennent, mais après le troisième ou quatrième toucher, la zone devenait douloureuse. Je ne pensais pas qu’ils continueraient, j’ai eu le sentiment de devenir un bout de viande. »
« Coupe, elle est cuite ! »
Il y a trois ans, Ninon* a été opéré d’un papillomavirus sur le col de l’utérus. « Des amies avaient bénéficié d’une anesthésie générale pour ce genre d’intervention, je voulais la même chose car je ne voulais pas être sanglée à la table. Ma gynécologue m’a dit que ça ne se faisait pas, que l’anesthésie locale était mieux. » Soit. Le moment venu, ce n’est même pas son auto-estime qui l’a fait souffrir mais la douleur de la cautérisation à cause de l’anesthésie locale inefficace. Le personnel a réagi, la mettant aussitôt sous gaz anesthésiant. « C’est bon, vas-y coupe, elle est cuite ! » a entendu Ninon. Loupé ! Pas encore, pas complètement.
De son côté, Axelle, 28 ans, a eu une mauvaise expérience avec une gynécologue installée dans le centre-ville dijonnais. Elle venait tout simplement chercher une méthode de contraception respectueuse de ses convictions, limitée en produits chimiques. « Elle m’a dit que j’étais inconsciente de ne pas prendre la pilule à mon âge et me l’a prescrite sans répondre à mes questions ni tenir compte de mes souhaits. » En plus de se sentir ignorée et infantilisée, la jeune femme a dû affronter un autre dénigrement après avoir opté pour une cup en cas de règles. « Ma gynécologue a critiqué mon choix et m’a invitée à utiliser des tampons. Elle a fait ça en s’asseyant face à moi alors que je me rhabillais, déjà gênée de la situation, j’avais encore les fesses à l’air… »
La lumière au bout du tunnel
Sur la base de ces témoignages glaçants quoique marginaux (encore heureux), le respect du professionnel de santé et la beauté de l’accouchement en ont pris un coup. Qu’on se rassure, le professionnalisme, le tact, le bon sens, la bienveillance et l’amour du métier existent encore. Les photos de bébés qui habillent les murs des bureaux du personnel soignant en sont les premiers signes visibles. Surtout, la profession médicale a fait évoluer ses pratiques dans l’intérêt de toutes et tous. Les maternités peuvent aussi s’appuyer sur le travail des psychologues qui accompagnent aussi bien les parents que les professionnels de santé, eux aussi confrontés aux émotions brutales. « Un refus d’être soigné peut aussi être une violence pour le personnel. Le médecin ne comprend pas toujours les réactions des patientes, souvent liées à leur passé. Le suivi et la discussion post-opératoire sont donc essentiels », insiste le professeur Sagot du CHU de Dijon. Et quand les mots ne suffisent pas à dissiper le traumatisme vécu, les patientes peuvent alors se tourner gratuitement vers la commission des usagers de l’hôpital (c’est elle qui recueille les plaintes), ou saisir la commission indemnisation et conciliation. Encore faut-il que ces dames osent mettre à bas le grand tabou. Pourvu qu’on y vienne toutes à bout.
* Certains prénoms ont été modifiés
« Rien à voir avec un viol, c’est de l’apprentissage »
Parmi les rumeurs sur le sujet, les touchers vaginaux sur des patientes sous anesthésie générale, inconscientes et non consentantes, figurent en bonne place. La réponse du chef de service au CHU de Dijon, est limpide : « Ça ne se fait plus. » La pratique a existé, longtemps. « C’était un temps de formation qui a disparu pour les futurs médecins », explique Paul Sagot, avant de s’interroger ouvertement sur l’efficacité d’un entraînement sur mannequin. « Insérer un spéculum (ndlr, l’outil permettant d’explorer une cavité par l’écartement des parois) pour la première fois n’est pas aisé et un mannequin ne remplace pas le toucher ; il faut appréhender la patiente dans sa réalité. Comment vont-ils apprendre sans cette étape pratique ? » Doit-on considérer cette intrusion non consentie comme un viol ? « Il y avait un but éducatif, nous sommes un centre universitaire, tranche l’intéressé. Cela n’a rien à voir avec un viol, c’est de l’apprentissage. » Désormais, le personnel devra faire confiance aux femmes et à leur consentement explicite.