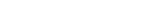Soixante-quinze ans séparent les Babyboomers et les Alphas. Les générations X, Y et Z viennent s’intercaler entre elles. Chacune d’elles portent un regard différent sur la société, ce qui provoque parfois l’incompréhension entre les plus jeunes et leurs aînés. Décryptage de ce « choc des générations » avec la consultante dijonnaise Aurélie Courtay.
Ah les jeunes ! Chacun l’a été un jour et pourtant, en vieillissant, nous sommes tous prompts à oublier cette époque. « Il faut distinguer une tendance et ne pas faire de généralités », prévient d’emblée Aurélie Courtay, consultante en organisation et stratégie en entreprise au sein du cabinet dijonnais Aura Conseil, spécialiste de l’analyse des générations. Grandir dans le plein emploi de l’après guerre, ce n’est pas tout à fait la même chose que vivre sa jeunesse dans une société confrontée au Sida et au chômage ou à l’époque d’internet et des réseaux sociaux. « On ne se construit pas dans le même monde selon son âge. On ne peut pas non plus avoir les mêmes attentes et les mêmes objectifs à 20 ans qu’à 50 ans. » Aurélie Courtay fait notamment référence aux débuts de l’indépendance. « On oublie par quoi on est passé et que ce n’est pas facile de vivre avec un Smic, de ne pas avoir de CDI… »
Pour autant, cette mémoire sélective n’est pas la seule responsable des conflits susceptibles de jaillir entre les générations. Quels seraient alors les profils caractéristiques de chacune de celles-ci ? La génération X (1964- 1978), considérée comme la génération sacrifiée avec des parents peu présents se consacrant à leur travail, a tenté de ne pas reproduire ce qu’elle a vécu, s’évertuant à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. « Ce sont des gens qui ont vu les crises et les licenciements. En réponse, ils ont développé une autre loyauté à l’entreprise, préférant capitaliser sur des compétences interchangeables car ils ont compris qu’ils l’étaient eux-mêmes. » Moins insouciants que leurs aînés Boomers, les membres de la génération X peinent à trouver des repères face à la crise économique, aux chocs technologiques, à l’effondrement des valeurs.

La génération Y, celle des enfants nés entre 1979 et 1995, est en quête de sens. « Ce sont les enfants de la mondialisation, de la technologie de l’information et du progrès. Ils arrêtent d’accepter sans comprendre. » Cette manie du questionnement peut être mal perçue par les aînés et par l’autorité, qui « peuvent avoir l’impression d’un manque de respect. Pourtant, ce sont leurs parents qui leur ont appris à exprimer leur avis, à poser des questions… » Si les Boomers et la génération X ont parfois du mal à interpréter les attitudes des Y, les difficultés sont plus grandes encore avec la génération Z (1996-2010).
« Les Z ont poussé à l’extrême les caractéristiques de la génération Y. Ce sont des individus aux désirs croissants, encouragés par la société de consommation. » Cette génération est aussi appelée génération C. C comme connecter, communiquer, créer, collaborer ou encore consommer. « Avec un bémol toutefois, tempère la consultante. Les études portent rarement sur les jeunes des milieux défavorisés. » Quand elle y a accès, cette génération est celle qui maîtrise les technologies et les utilise pour se faciliter la vie et gagner du temps. « Ils sont multitâches, et cela perturbe les moins jeunes, convaincus qu’ils ne savent pas se concentrer. » Habitués des nouveaux modes de communication, ils ont appris à se mettre en scène, savent identifier leur meilleur profil pour une photo sur Instagram. « Ils ont une vision plus superficielle mais c’est aussi la génération la plus instruite car elle bénéficie d’un accès plus rapide et plus facile à l’information. » Ils sont scotchés à leur téléphone ? Aurélie Courtay sourit : « Ils ne font que reproduire le comportement de leurs parents ! »
En entreprise, les conflits entre générations sont bien réels mais ils révèlent d’abord d’un manque de communication.
En entreprise, les conflits entre générations sont bien réels mais, à en croire Aurélie Courtay, ils relèvent d’abord d’un manque de communication. « Le jeune voit un patron qui n’est jamais content de lui alors il préfère s’abstenir d’agir, n’osant pas demander conseil. De son côté, le plus âgé voit un refus de l’autorité. » Pourtant les plus jeunes, Y et Z en particulier, ne manquent pas de qualités. Ils sont plus autonomes, désireux de faire les choses par eux-mêmes, mais avec une constante recherche de reconnaissance. « Habitués aux jeux vidéo, ils attendent une évaluation juste de leur travail. Ça passe notamment par un besoin plus marqué de voir leur responsable, mais moins longtemps. » Ils sont accusés parfois de ne pas avoir hérité de la valeur travail.
Pourtant, la moitié des moins de 25 ans envisage de créer une entreprise. Dans leur vie professionnelle comme ailleurs, le plaisir prévaut pour les individus nés après 1996, attachés à vivre leurs émotions. Plus que par l’argent, ils seront motivés par l’implication, par la présence d’un mentor ou encore par le fait de se voir confier des responsabilités. « Cette génération veut jouer un rôle dans la société mais ces jeunes qui assument leurs convictions dérangent. » À l’image de Greta Thunberg, militante de l’environnement, ou de Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix 2014 pour son combat contre l’oppression des enfants et pour le droit à l’éducation. Le mouvement #metoo, particulièrement relayé par la jeune génération, traduit aussi ce besoin d’engagement. Le monde change toujours plus vite. Déstabilisés, les plus âgés peuvent choisir entre regretter celui d’hier ou, avec l’aide des plus jeunes, s’approprier celui d’aujourd’hui. En attendant qu’ils se décident, la génération Alpha – les enfants nés à partir de 2001 – a déjà commencé à se forger un profil.